À vol d’oiseau, le village de Pomerac se situe à environ 25 km au nord du centre de Montpellier et à 12 km au sud-ouest de Quissac. Le territoire communal s’étend sur les pentes de la crête de Taillade (420 mètres) au nord et de la montagne du Causse à l’ouest. Les ruisseaux intermittents qui s’y écoulent, tel le Gorniès, se dirigent vers le Gard et le Brestalou, un affluent du Vidourle. L’ensemble des crêtes qui dominent la plaine de Pomerac forme un croissant ouvert vers l’Est. Pomerac est proche de la route départementale 17 (D45 dans le Gard) qui relie Montpellier à Quissac, en passant par Saint-Mathieu-de-Tréviers. Au sommet de la crête de Taillade, la route départementale desservant le village rejoint la départementale gardoise no 25 qui dessert Saint-Hippolyte-du-Fort. (Wikipedia)
Il fallait prendre un lieu, et j’ai choisi celui-là. Non parce qu’il m’était familier (il l’était), mais parce que je venais d’emménager dans ce lieu, et je voyais là un moyen de me l’approprier plus rapidement ; je voulais que ce lieu me devienne intime, en plus d’être le lieu de l’intime. Je voulais créer avec lui une relation particulière, tisser entre ce lieu et moi un lien unique : en connaitre les évolutions et les secrets, quand bien même ces évolutions et ces secrets relèveraient de mon seul imaginaire. Mais un imaginaire qui par le biais de l’écrit s’impose comme possible, puis comme probable, et enfin, comme seule réalité objective.
Deux personnes, un homme et une femme, et le lieu prend vie. Autour de ce lieu, je construis une maison. Autour de cette maison, un village. Je nomme ce village, et le village s’anime. Il y a d’autres gens dans ce village. Pour tous, ce sont des silhouettes aperçues, des histoires entendues, plus ou moins floues, toutes recréées, réinventées, pour venir peupler le lieu. Parmi ces personnes, certaines viennent de plus loin, et le lieu prend une dimension spatiale ; d’autres viennent après, et le lieu prend une dimension temporelle.
Il n’y a pas de but ni de fin définis.
Ce moment-là, le premier, pourrait être l’été. Et s’il s’agit de l’été, alors il fait bon, pas trop chaud à cette heure encore matinale. Comme c’est l’été, et comme c’est le Sud, il y a des cigales qui chantent. Elles sont en contre-bas, dans la forêt, après le cours d’eau asséché, et si l’on s’assoit sur l’une des chaises de jardin disposées sur la terrasse, on ne perçoit d’abord que ça. Après seulement, on entend les oiseaux, le bourdonnement encore discret des insectes, les bruissements des feuilles dans les arbres, et enfin, au loin, quelques voitures qui passent. En face de nous, il y a le vieux mûrier au tronc creux, usé par les années — il était là avant la maison, construite il y a 150 ans —, et qui chaque printemps refleurit. La forêt en contre-bas, on ne la voit pas, elle est cachée par un vieux drap posé sur un fil, étendu là sans doute la veille et que quelqu’un a oublié de rentrer. À droite, un escalier conduit à la maison, il y a une petite avancée en haut des quelques marches et le garde-corps est rongé par la rouille. La peinture d’origine était verte, et ce vert mêlé de rouille forme une assez jolie texture. Il y a une marquise aussi, au-dessus de la porte qui mène à la maison, dont l’un des carreaux est cassé, et il y a devant la porte un grand volet en fer, également rouillé, qui est fermé. L’escalier, comme le reste, porte le passage du temps, les contremarches envahies de mousse, le nez des marches polies par les pas portés, et sur l’échiffre une fissure court tout du long. Si on se retournait, on verrait un mur de parpaings brut. En face, derrière le vieux mûrier, trois marches encore, conduisent à une porte vitrée qui ouvre sur la cuisine.
Au sortir de la guerre, il y avait là une forge. Les murs étaient de tôles ondulées et de planches de bois, et entre les deux, tout un bric-à-brac de casseroles, de tuyaux et toutes autres pièces métalliques inutilisables ajoutées régulièrement au fourre-tout qui maintenait l’ensemble dans un équilibre précaire. Le sol était en terre battue, contre le mur du fond reposait le foyer alimenté au charbon et il fallait actionner la soufflerie pour obtenir la chaleur de chauffe et maintenir la température. À côté, une enclume et une cuve remplie d’eau, et, posés contre, les outils : pinces, marteaux, poinçons, cisailles, brosses et autres limes. Sur le côté, jouxtant la cheminée, il y avait une verrière constituée de petits carreaux qu’il était possible d’ouvrir, et si certains étaient cassés, avec la forge qui tournait toute l’année, il ne faisait jamais froid dans la pièce. Un gros chat noir et blanc passait parfois par là, furtivement, mais s’échappait bien vite pour rejoindre sa maîtresse sur la terrasse à la recherche de caresses. C’est une crème avait-elle coutume de dire, vous savez, il ne ferait même pas de mal à une souris, et lorsqu’il disparut à un âge avancé, elle le chercha longuement, avant de le trouver couché en boule dans l’espace qu’il y a sous l’escalier qui conduit à la maison. Il s’était allongé là, seul, pour mourir. Elle en eut le cœur brisé et ne se résolut jamais à l’en sortir, se contentant de faire poser par son mari devant l’ouverture une plaque de métal fixée dans le béton, fermant ainsi la sépulture qu’il s’était lui-même choisie.
Trente plus tard, il y est encore, lorsque les nouveaux propriétaires de la maison font démonter la forge et monter le mur de parpaings brut. Touchés par l’histoire de la vieille dame, ils ne toucheront pas au tombeau improvisé du gros chat noir et blanc. Ils ont par contre fait enlever le bric-à-brac qui tenait lieu de cloison, là où était la forge, et tendre des bâches à la place de la verrière, pour cacher le vis-à-vis, en attendant que soient achevés les travaux. Comme c’est dimanche et qu’il fait encore beau en cette toute fin de septembre, ils ont invité des voisins à déjeuner. La table est mise au milieu de la pièce, et la toiture ayant disparue du fait des travaux, il y a un grand parasol blanc ouvert, posé contre l’ancienne cheminée.
Sur la terrasse, sous l’escalier, non loin de là où repose le chat, on a retrouvé des bonbonnes de verre de différentes tailles, quelques-unes habillées de paille, contenant du vin de noix. On ne sait de quand date le vin, et il y a au fond des bonbonnes un épais dépôt, mais on décide de le goûter quand même. Il faut d’abord faire sauter les larges bouchons de liège, et c’est toute une histoire, les tire-bouchons n’y suffisent pas, on s’y essaie à tour de rôle, cela devient un jeu. Et lorsque les verres sont remplis on hésite encore, dans la lumière du soleil de fines particules de sédiments apparaissent dans le liquide ambré, mais, allez, on trinque quand même, et le vin est bon, délicieusement sucré, presque sirupeux.
Tout l’hiver on a pu croire le mûrier mort, mais au printemps les premiers bourgeons apparaissent, les tiges s’allongent, recouvertes de grandes feuilles polymorphes, et l’on se mettra bientôt dessous le midi pour déjeuner, à l’abri du soleil. Le gros chat noir et blanc est couché sur la terrasse, sa maîtresse est sortie et il est seul dans la maison avec le forgeron. Il observe depuis quelques jours le ballet des mésanges qui vont de la forêt au mûrier, et il sait que c’est là qu’elles vont faire leur nid. Le chat est patient, c’est dans sa nature, et il observe longtemps le manège des oiseaux. Quand il est sûr de son fait, il se glisse jusqu’à l’arbre et sans un bruit grimpe le long des branches. Le forgeron vient d’arrêter son travail quand il entend un cri bref et se précipite jusqu’à la terrasse, et voit le chat en arrêt sur le tronc du mûrier. Celui-ci semble hésiter, il observe son maitre, le jauge de son regard froid et dur de chasseur. La queue de sa proie, déjà morte, dépasse de sa gueule. D’un bon il saute de l’arbre et disparait dans l’espace qu’il y a sous l’escalier qui conduit à la maison. Le forgeron, attristé, ne dira pas un mot de tout cela à sa femme lorsqu’elle rentrera, et personne ne saura jamais rien de cet épisode.
Ainsi, du village, je ne savais rien. Je savais les rumeurs et je savais les bruits, mais rien n’était écrit, aucune trace ne subsistait pour témoigner. Chaque génération qui partait emportait avec elle ses secrets. Je suis allé au cimetière, et les inscriptions sur les pierres sont un début d’histoire : on a un nom, et on a une date qui amorce un récit ; on a une date qui le clôt. Mais de l’histoire elle-même, on ne connait rien. Je suis allé interroger les anciens, mais ils ne parlent pas. Va donc voir Monique, me dit Lucien. Je ne sais plus, me dit Monique, demande plutôt à la Simone. Simone ? Elle n’est plus là. Demandez à Lucien. Et ainsi j’ai fait le tour du village et j’ai fait le tour de la place. J’ai voulu voir les registres et la mairie était fermée et comme il faisait chaud et que j’avais soif, je suis venu ici. Mais vraiment, c’est par là que j’aurai dû commencer. Le café, dans la rue principale, comme l’église, est le réceptacle de toutes les confessions, et le café reste ouvert quand l’église est fermée en dehors des offices.
L’appellation «rue principale» était alors un euphémisme : ainsi quand Ibrahim Jabbar en foula le sol pour la première fois, il n’y avait à proprement parler qu’une rue à Pomerac, que croisaient des chemins communaux et quelques allées. Depuis une dizaine d’années, le plan local d’urbanisme a permis la construction de résidences privées et de quelques lotissements sur d’anciens champs de vignes dépendants du village, qui ont nécessité un aménagement conséquent de la voirie.
L’arrivée d’Ibrahim Jabbar au village coïncida avec la venue de l’hiver. Certains prétendront qu’il était venu à pied depuis l’Espagne, d’autres qu’il avait surgi au milieu de la nuit, et toujours, parmi les vieux villageois, on lui prêtera une aura sulfureuse. Il apparut un soir d’épais brouillard, remontant la rue principale pour rejoindre la place et pousser la porte du café.
Il y avait là l’amiral, attablé au comptoir depuis le matin — tellement saoul tout le temps que les gens par ici disaient qu’il était accompagné —, un groupe de quatre jeunes sur le point de partir, le patron derrière son bar et la serveuse occupée à nettoyer les tables, et tous se figèrent lorsque la porte s’ouvrit et que sa longue silhouette, enveloppée dans un grand manteau noir et précédée d’un vent glaçant, entra en silence dans la salle. Il faisait presque deux mètres, et comme souvent les gens très grands, se tenait légèrement vouté. Il salua l’assistance avec un fort accent étranger, s’avança jusqu’au comptoir et, posant à ses pieds l’étui qui abritait son instrument (on saura par la suite qu’il jouait du saxophone), commanda un thé. Il était coiffé d’un kufi, mais ce qui intrigua le plus les jeunes, et qui alimenta leur discussion tandis qu’ils marchaient pour rejoindre leur voiture, c’était qu’en dépit du froid, il portait des sandales.
A Pomerac, les jeunes semblent tous être sur le point de partir. La plupart finissent de fait par s’en aller tenter leur chance ailleurs, et, assez paradoxalement, ils sont remplacés par de jeunes couples avec enfants, fuyant les grandes villes. Mais pour les anciens, ces jeunes-là seront toujours des “estrangers”.
Vous aviez acheté la maison cinq ans auparavant, et au début vous ne pensiez venir que pour les vacances. Mais quand les travaux furent finis, et comme il avait fait des placements qui rapportaient beaucoup, il t’avait proposé de t’arrêter de travailler, pour que tu vives ici toute l’année.
Sans toi ? avais-tu demandé. Au début oui, avait-il dit. Seulement au début. Ensuite, je ne bosserai qu’à mi-temps, et je serai là le reste de la semaine avec toi. C’était juillet, il faisait beau et tu avais dit oui. Quelques mois plus tard, seule dans la maison et en plein mois de décembre, tu te prenais à douter du bien-fondé de sa décision. Tu t’étais décidée à lui en parler ce soir. Tu pris ton sac et sortis. Ta voiture, une jaguar XJS de 1991, trop large pour le garage, était garée sur le trottoir en face de la maison. Ça t’amusa de voir qu’à côté d’elle stationnait une vieille 4L bleue. Ton mari arrivait par le train dans moins d’une heure, et il te fallait un peu plus de trente minutes pour rejoindre Montpellier depuis Pomerac. Tu sortais du village quand tu surpris dans la lumière des phares une grande silhouette sombre et voutée qui venait en sens inverse. Perdue dans tes pensées, te répétant inlassablement les phrases que tu voulais dire à ton mari, tu l’oublias presque aussitôt.
Le froid, vif et humide. La nuit, déjà. Se dépêcher. Pas loin à aller, mais avec ce brouillard, mieux vaut rouler doucement. Avec ta caisse, pas possible d’aller vite, de toute façon !
Bizarre ce type, non ? Son étui… Un instrument ? Un sax ? Ah ouais, peut-être… Et son truc sur la tête, chelou, non ? Et ses sandales, surtout ! Chacun s’interroge. Les hypothèses, de plus en plus farfelues. Les rires qui fusent.
D’autres préoccupations : la bière ? Dans le coffre, pas d’inquiétude. Et le reste ? Leo s’arrête, sort un paquet de sa poche à l’intention des trois autres. Sourires. Un regard entendu. Maintenant ? Et pourquoi pas ? Dans la voiture, alors. La 4L, toujours là. La Jag, par contre, a disparu. Personne autour. On s’installe. Les feuilles ? Ici. Cigarette ? Voilà. Briquet ? Tiens.
La clé dans le contact. Rien. Batterie HS. Il faut pousser. Ah non, pas par ce temps ! Ben si… allez, courage les gars ! Crissements des pneus sur l’asphalte, soubresauts de l’embrayage, hoquets du moteur, et enfin, ça roule. La course derrière la voiture maintenant, le claquement des portes, tout le monde à bord. Leo, resté au volant, passe le joint. La radio à présent allumée. Les Beatles. A hard day’s night. Pour nous, les gars ! Quatre garçons dans l’brouillard ! Leo, encore.
Ibrahim Jabbar arrivait de Séville. Non pas directement : il venait de Montpellier, en stop. Mais il avait vécu une dizaine d’années à Séville. Après une rupture amoureuse, il était parti tenter sa chance à Paris. Un ami musicien lui avait proposé de jouer sur son album. L’enregistrement aurait lieu dans un studio perdu dans les hauteurs de Pomerac. Ils avaient convenu de se retrouver au café du village.
Quand il arriva ici pour la première fois, il n’était pas beaucoup plus tard que 21 heures, mais la nuit tombe vite en hiver, et dans la mémoire collective du village, Jabbar, longtemps le seul noir à arpenter les rues de Pomerac, était paré d’une image sulfureuse.
La route qui conduit au village est tortueuse et sombre. Qu’il arrive ainsi le soir et en hiver ne fut pas reçu comme un bon présage.
Ibrahim Jabbar est né Cécil Jones, à Bonham, dans le conté de Fannon, au nord-est du Texas, à 20 kilomètres au sud de l’Oklahoma et une centaine de kilomètres au sud-est de Dallas. Il est multi-instrumentiste, mais le saxophone et la flute sont ses instruments de prédilection. Ibrahim est le nom musulman d’Abraham, dans la Genèse. Jabbar est un prénom arabe qui porte en lui la notion de puissance. Il a choisi de se faire appeler ainsi après s’être converti à l’Islam. Parti combattre au Vietnam, il est rentré chez lui en 1975 dans un pays qui ne savait que faire de ses vétérans. Après quelques errances, il trouva dans le Coran la paix qu’il recherchait avec son coeur.
Ibrahim Jabbar, sous son manteau noir, est toujours vêtu d’une sorte de caftan, en fait une tenue traditionnelle chinoise, qu’il porte en hommage à Bruce Lee (il a trois modèles : Mohamed Ali, John Coltrane et Bruce Lee), quand on imaginerait au premier coup d’oeil que cela a à voir avec sa religion.
Dans le train, ça semblait si simple. Il te suffisait de t’asseoir auprès d’elle et de tout lui dire. Lui dire que ça n’avait rien à voir avec elle, que tout était de ta faute. En sortant de la gare, tu l’as vue qui venait vers toi, elle semblait heureuse. Elle t’a embrassé et machinalement, tu l’as embrassée à ton tour. Elle t’a pris par la main et c’est elle qui a commencé de te parler. Elle t’a parlé du village, elle t’a parlé de la maison et des travaux, elle t’a parlé des voisins et de combien tu lui manquais. Elle a dit qu’elle ne voulait plus être seule. Vous avez marché jusqu’au parking, elle qui parlait et toi qui trainais en silence ta valise, ruminant tes pensées. Plus tu attendais et plus ça serait difficile. Tu aurais dû l’arrêter et tout lui dire maintenant. Et puis t’en aller. Prendre un train et repartir pour Paris. Et surtout, ne pas monter dans la voiture. Mais c’était déjà trop tard. Vous rouliez depuis vingt minutes et le silence vous enveloppait aussi sûrement que le brouillard dehors recouvrait tout, tu n’avais encore rien dit et déjà des panneaux précisaient que vous n’étiez plus qu’à quelques kilomètres de Pomerac. Tu posas soudain ta main sur la sienne, qui était sur le levier de vitesse, et tu lui dis écoute, il faut que je te parle, mais elle te coupa net et dit : attends ! Elle te dit : c’est quoi, devant ? Un accident ? Il y avait devant vous sur le bas-côté des pompiers qui s’activaient dans la lumière des gyrophares, et au moment de passer près d’eux tu aperçus dans le fossé ce qui te sembla être l’aile arrière d’une vieille 4L.
Les vieux villageois constituaient le tiers de la population de Pomerac, mais leur pouvoir de nuisance était considérable. Entendons-nous bien : ces gens pris isolément pouvaient s’avérer charmants, mais ils vivaient dans une sorte d’autarcie malsaine qui les rendait méfiants à l’égard de ceux qu’ils ne connaissaient pas, devenaient vite la cible de leurs médisances, décourageant jusqu’aux plus conciliantes des meilleures volontés.
Ça faisait plus de dix ans que je n’avais pas mis les pieds à Pomerac. Et je n’y serais pas revenu, si ce n’était pour Micheline. Pour l’enterrement de Micheline. Enfant, je passais tous mes étés ici chez mes grands-parents. Micheline nous offrait des goûters à moi et à ma sœur, et nous laissait jouer des après-midi entiers sur sa terrasse tandis qu’elle prenait le thé avec ma grand-mère. Quand Ernest, son mari, qui était forgeron, mourut quinze ans plus tôt, une des commères du village, croyant bien faire, lui adressa une lettre de condoléances. Elle lui écrivait quelle était bien triste de voir partir un monsieur si gentil et que c’était presque comme s’il faisait maintenant partie du village (et elle aussi Micheline, bien sûr, crut-elle bon de préciser).
Tu te rends compte ! dit-elle à ma grand-mère après lui avoir lu la lettre, tu te rends compte, on est arrivé ici il y a 60 ans et pour eux on est encore des étrangers !
Pourtant tout le monde était là, aujourd’hui, pour l’oraison du prêtre, et tous ont suivi la lente procession depuis l’église jusqu’au cimetière. Il y avait la famille qui ouvrait la marche, accompagnée du maire et de ses adjoints, suivis des amis, et tous les autres derrière eux. On passa devant la place où seul le bar était resté ouvert, le patron sachant bien que les enterrements donnent soif, mais il n’y avait personne à l’intérieur, même l’amiral c’était joint au cortège. Plus bas, enfin, on s’arrêta quelques instants devant la maison de Micheline, pour marquer une minute de silence. C’est alors que Léo, le petit du boulanger, coincé dans les bras de son père, se mit à pleurer, et ce moment fut étonnamment beau.
L’amiral n’a jamais été marin, mis il porte en permanence une casquette Comodore qui lui vaut son surnom, qui, vu son penchant pour l’alcool, aurait tout aussi bien pu lui valoir celui de capitaine Haddock. Au bar, les clients sont rares, et les habitués en général accoudés au comptoir. Le patron est derrière son zinc : Il n’en sort que rarement, et de se tenir ainsi, les mains posées bien à plat devant lui, à deviser sur le monde dans un perpétuel monologue, homme-tronc secouant négativement sa tête à intervalles réguliers ponctués de longs soupirs, on lui prête la même aura qu’aux présentateurs du journal télévisé de la mi-journée.
Ce qu’on voyait d’abord d’Ernest, c’était son béret, ce béret bleu nuit posé négligemment sur sa tête, selon une mode dont nous avons perdu les codes mais dont nous retrouvons encore trace dans de vieilles photos jaunies. C’est ce béret bleu qui le définissait le mieux, comme il définissait les hommes de sa génération. Ce béret, comme signe d’appartenance, et qui ne disait rien d’autre que son âge. Un béret dit basque, quand il vient du Béarn, en feutre avec une bordure intérieure en cuir tanné par les ans, usé par le frottement contre son cuir à lui — et qui sait les pensées qu’il a abritées, les mots envolés, les paroles perdues qui sont nées là-dessous, sous ce cuir et ce feutre ? —, surmonté d’un coudic, cette petite queue de laine, minuscule, qui identifie à elle seule le béret et qui autrefois, quand il était tricoté à la main avant d’être feutré, était l’extrémité des fils, mais qui depuis, comme tout est fait maintenant par des machines, est rajouté après. Le sien, authentique, et il y tenait, venait d’un chapelier situé à Montpellier, à deux pas de la place Jean Jaurès, était fait main selon la tradition.
Dessous, son visage impassible, non pas fermé mais indéchiffrable, son visage de sphinx. Ses yeux bleus très clairs qui avaient vu passer deux guerres, qui de la première avaient regardé partir ses frères sans jamais les voir revenir, et de la seconde avaient contemplé des choses dont il ne parlait pas, parce qu’en parler alors l’aurait condamné à mort et qu’après, c’était sa fierté de n’en rien dire, et c’est Micheline qui en parlait, et qui disait le héros qu’il était. Micheline, éternellement figée dans la beauté de ses quinze ans de moins que lui, et devant qui une fois, pour une seule photo, il ouvrit ses lèvres en un beau sourire, dévoilant ses dents se chevauchant devant, ses dents de guingois dont il se moquait éperdument, ce sourire maladroit et touchant qu’il ne réservait qu’à elle que personne ne lui avait vu auparavant, le seul maintenant qu’on lui connaît, ce sourire qui aujourd’hui le défini, éclatant sous son béret bleu nuit, dans ce petit cadre d’acier posé sur sa tombe.
2 août 1914. C’est la guerre. Il a 15 ans. Trop jeune pour partir, il reste seul avec ses parents. Ses deux frères, mobilisés, il ne les reverra plus. Il a 16 ans. Il se forme au métier de forgeron. Le métier est dur, mais il apprend vite. Il se marie à 20 ans. Il quitte ses parents pour s’installer avec sa femme dans un village voisin, distant de quelques kilomètres. Cela fait trois ans qu’il est installé à Pomerac et les villageois le regardent toujours avec un peu de méfiance, mais il s’en moque. Il a repris l’ancienne forge et vit là-haut avec sa femme. Il a du travail, on l’appelle partout, il connait tout le monde. Il sait tout des petites histoires, des secrets de familles et des adultères. Il tient des carnets dans lesquels il note ce qu’il apprend. Il sait tout, mais à 30 ans, lorsqu’il rentre chez lui et trouve la maison vide, il comprend qu’il ne savait rien de sa femme. Elle ne lui laisse que la forge et un chagrin immense qu’il noie dans le travail. Il ne divorcera pas. Il est bel homme et bien bâti. Les filles le regardent, mais pour l’instant, lui ne les voit pas. Il a 77 ans et il ne voit plus rien. Il est depuis un mois sur un lit d’hôpital. Ce n’est pas encore l’été, et c’est déjà la canicule. Albert Spaggiari est sur le point de réaliser le casse du siècle, mais il n’en saura jamais rien : il meurt un mois avant. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne. Cette fois, il part. Il revient à l’été 1940. Il n’entend pas l’appel du 18 juin, mais en entend parler. Il ne dit rien, il laisse dire. Il n’aime pas Pétain. En janvier 1943, l’armée allemande envahit la zone libre. Dans les Cévennes, et de la Lozère à l’Aveyron, le Maquis s’organise. Il lui faut des relais. Il lui faut des hommes sûrs. Il sera de ceux-là. En 1935, il croise pour la première fois Micheline. Elle n’a que 25 ans, il en a 15 de plus. Il est subjugué par sa beauté. Elle vit seule au village. Dans ses carnets, à la date du 9 juillet, il écrit : hier soir, elle s’est donnée à moi pour la première fois. J’en suis resté ébloui. Leur liaison fera les choux gras des cancans des commères. Ils ne se quitteront jamais. Après la guerre, la vie reprend. Il ne tire aucun profit de ses actes de résistance. Il a 40 ans. Il s’installe chez elle. Il construit sa forge dans la vieille pièce du fond, et quand il se retourne, il voit par la fenêtre le vieux mûrier. Il fait quelques pas encore et il la voit sur la terrasse, avec son chat sur les genoux. Quand il est fatigué, épuisé par le travail et la chaleur de la forge, ou quand il doute, comme aux heures les plus sombres de la guerre, il se retourne toujours pour la regarder. Et cet amour est infini. A 50 ans, il se résigne : il sait maintenant qu’ils n’auront jamais d’enfants. Mais leur amour est infini.
C’est en mai 1991, le 23, deux cent vingt-deux jours avant la fin de l’année, que Micheline est morte. Ce jeudi, à Paris, le soleil se lève à six heures cinq et se couche à vingt et une heures trente. À Pomerac, c’est à seize heures cinquante-deux que Micheline s’est éteinte. Dans le Golfe, la guerre se termine, le Koweït est libéré, les puits de pétrole brûlent depuis février et les troupes de Saddam Hussein massacrent les Kurdes et les chiites accusés de collaboration avec la coalition ennemie. Le 18, une guerre civile éclate en Somalie. En Inde, le 21, Rajiv Gandhi est assassiné. Le même jour, le Soviet suprême vote un projet de loi libéralisant les voyages à l’étranger pour les ressortissants soviétiques. Le 26, à vingt-trois heures et deux minutes, heure locale, le Boeing 767–3Z9ER de la compagnie Lauda Air, immatriculé OE-LAV, vol 004 en provenance de Hong Kong et à destination de Vienne redécolle de Bangkok où il a fait escale. Dix minutes et vingt secondes après le décollage, le copilote Josef Thurner, 41 ans, prévient le commandant de bord Thomas John Welch, 48 ans, d’un problème technique. Quinze minutes et une seconde après le décollage, Thurner informe Welch de la mise en route accidentelle d’un des inverseurs de poussée. Vingt et une secondes plus tard, l’enregistrement des conversations de bord prend fin dans un fracas de tôles tandis que l’appareil, en chute libre, se disloque à 1200 mètres d’altitude, à environ 94 miles nautiques au nord-ouest de Bangkok. Aucun des deux cent treize passagers et des dix membres d’équipage ne survécut à la catastrophe. Il est dix heures, heure locale, le lundi 27 mai, lorsque Micheline est portée en terre, au cimetière de Pomerac. Leo a cinq ans et pleure dans les bras de son père. Beaucoup, dans le cortège, ont en tête le drame survenu la veille au-dessus de la Thaïlande.
Micheline est enterrée au côté de son mari Ernest, parti quinze ans avant elle, le 16 juin 1976, tandis qu’à Soweto éclatent de violentes émeutes raciales. Un peu plus de deux mois auparavant, à Cupertino, en Californie, Ronald Wayne, 41 ans, accepte de se joindre à deux jeunes informaticiens de 21 et 26 ans — tous les deux prénommés Steve — pour créer Apple Computer inc. Le 16 juillet, le Canada abolit la peine de mort. Le 28, à T’Ang Chan, en Chine, un tremblement de terre de magnitude 8.0 fait 240 000 morts. Vingt-quatre jours plus tôt, le 4 juillet, les États-Unis fêtent le bicentenaire de leur indépendance. Le lendemain, Cecil Jones, 26 ans lui aussi, rentré l’année précédente du Vietnam, décide de quitter le Texas et part tenter sa chance comme musicien à New York. Il commence à tourner dans les clubs et enregistre bientôt son premier album, sur lequel il joue de la flute et du saxophone, mais aussi, sur un morceau, du piano. Il quitte définitivement les États-Unis en 1986, partant s’installer à Séville, en Espagne, après s’être converti à l’Islam. Il se fait désormais appeler Ibrahim Jabbar. Le 2 octobre de la même année, à 1370 kilomètres de là, nait Leo, le fils du boulanger de Pomerac. Avant lui, à New York, le 28 mars c’est Stefani Joanne Angelina Germanotta, Robert Thomas Pattinson à Londres le 13 mai, et le 3 juin, à Majorque, Rafael Nadal Parera, tandis que meurent à Paris Simone de Beauvoir le 14 avril et Jean Genet le 15.
C’est le 8 octobre 1997, le jour où s’ouvre à Bordeaux le procès de Maurice Papon, que tu rachètes à sa sœur la maison de Micheline, où, enfant, je jouais tous les étés. Lady Diana est morte à Paris dans un accident de voiture le 31 août et on ne parle encore que de ça dans les médias. Le 8 novembre, Jacques Chirac suspend la conscription en France. Les cassettes VHS disparaissent peu à peu tandis que s’impose un nouveau support pour les fichiers vidéo, le Digital Versatile Disc. Cette année sont également morts un universitaire français, un chanteur de country et une actrice américaine, un prince éthiopien, un cinéaste mexicain, un peintre néerlandais, un designer italien, une religieuse indienne, prix Nobel de la paix en 1979, le plus petit homme au monde, une femme rescapée du naufrage du Titanic, un mystique tibétain, la doyenne française de l’humanité, un dessinateur belge, le chef du parti communiste français, un chanteur australien, ainsi que 59 millions d’autres personnes, 158 857 par jour précisément, quand dans le même temps il est né 353 015 enfants, 128,85 millions en trois cent soixante-cinq jours, ce qui est à peu près le temps qu’il faut à la terre pour réaliser son orbite complète autour du soleil à la vitesse de 29,8 km/s, et dans le temps qu’il faut à la terre pour parcourir ces 29,8 kilomètres, 13 000 couples font l’amour, exactement comme vous deux, en cet après-midi ensoleillé et sec du 8 octobre 1997, lorsque les portes de votre nouvelle maison se sont enfin refermées sur vous.
« “Encore un ?”, t’as fait et t’as même pas attendu que je te réponde, tu m’as rempli mon verre, parce que je n’ai même plus besoin de rien dire, la réponse est oui, toujours oui, des dizaines de oui si souvent dits qu’ils en donnent soif, et avant, je disais non, pas non à un verre, mais non quand on me disait “tu bois trop”, je disais non, et après, on me disait simplement “tu bois ?” et je disais non pareil, et je buvais pareil et le médecin, c’est elle qui m’a fait comprendre, elle m’a pas dit “tu bois ?” ou “vous buvez ?”, moins méprisant peut-être — et pourquoi d’ailleurs, parce qu’on est saoul, on nous tutoie ? Qu’est-ce qu’on a perdu d’humanité qui nous ramène à être un moins que rien dans le regard de l’autre ? Qu’est-ce qu’il en sait, l’autre, de ce par quoi on est passé, des épreuves, des douleurs, des blessures, ces choses qu’il ne connait pas, et qui peut être nous font boire, mais nous rendent tellement plus lucide sur le monde, sur son monde, à ce crétin, le monde qui l’entoure et qu’il ne voit même pas alors que ça l’enserre tout autour, ça le compresse de partout et il ne sent rien (pour l’instant, il ne sent rien, attends un peu que ça te tombe vraiment dessus, hein, attends un peu, on trinquera ensemble alors) — le médecin, ouais, elle m’a pas regardé de haut, du haut de son statut, elle m’a pas méprisé ni déconsidéré ni rien, elle m’a juste demandé “vous picolez ?” et j’ai dit oui, j’ai dit un peu, “trop, peut-être ?” elle a fait, “je peux vous aider, vous savez ?” elle a dit, mais moi je veux pas être aidé, je veux pas ne pas boire : lucide, c’est tout, je peux pas m’arrêter, et je veux pas et quand ils disent qu’on boit pour oublier, c’est des conneries, ils disent ça et ils se gavent d’antidépresseurs qui les endorment, mais moi je dors pas, moi je vois tout, et l’alcool ça aide à tenir, c’est comme ça, ça occupe en attendant — pas attendre que ça passe, parce que ça passera pas, je le sais ça —, y’a rien à faire qu’attendre de crever et voilà, y’a rien d’autre : on vit dans un monde fini, parce que nous sommes nous-mêmes prisonniers des frontières de notre corps — le monde dans lequel nous vivons est faux, il est le rêve mauvais des paresseux, de tous ceux qui ont abdiqué, de tous les résignés, et pour les autres, les écorchés vifs, les sages, les simples d’esprit, les marginaux et les alcoolos, il faut lutter encore et toujours, chercher à faire tomber les barrières, les remparts qui emprisonnent, dans ce monde et dans ce corps —, et celui qui boit, tu vois, il ne cherche qu’à repousser les limites, il veut faire voler en éclat les liens qui le retiennent et plus il boit, plus son corps devient poreux, mais les entraves ne cèdent pas, alors il lutte, il cogne et il crie, mais sa colère et son désespoir l’isolent un peu plus, mais ça personne ne le voit, hein ? Tu vois rien, toi, au comptoir, tu vois que l’amiral qui rentre le matin dans ton bar et qui n’en sortira qu’au soir, jusqu’au jour où il en ressortira les pieds devant, c’est ça que tu te dis, et le mépris, il est dans tes yeux, et parfois mêlé d’un peu de pitié, mais j’en veux pas, moi, de ta pitié, je veux rien d’autre que boire, je veux rien, ou alors qu’on me ramène mon frère, mon jumeau adoré, mon double lumineux, mais il est parti pour de bon, il est mort et y’a plus rien à faire qu’à boire parce que c’est trop dur de vivre sans lui, de vivre avec le regard des autres qui se disent en me voyant que décidément, c’est toujours les meilleurs qui partent les premiers, qui disent à voix basse ce que pensaient tout haut nos parents, si fort ils le pensaient qu’ils auraient pu le hurler et je ne l’aurais pas mieux entendu, et moi aussi je pense pareil, et y’a que mon frère qui disait que c’était pas vrai, y’a que lui qui m’aimait, il m’aimait comme un frère, et il m’aimait comme un père, et il me disait que j’étais le meilleur, que personne ne me comprenait pour ça, mais que lui il voyait qui j’étais à l’intérieur et il disait que ce qu’il voyait était beau, mais aujourd’hui y’a plus personne pour le voir. De toute façon j’ai construit un mur maintenant, pour pas qu’on voie au travers : ça me va d’être réduit à un stéréotype, ça rend les choses plus simples, personne n’attend plus rien de moi — l’amiral, qu’ils disent, et y’a rien d’autre à dire, hein, l’amiral, et c’est un sourire entendu, l’amiral avec sa casquette, que c’est son frère qui lui avait donné, et c’est lui aussi qui l’appelait ainsi, qu’on sait pas pourquoi, et là encore, les regards en coin —, et moi je passe ma route, je fais comme si je voyais pas, je continue d’avancer, le chemin est sinueux, mais j’avance, et avec l’alcool, même quand la route est droite y’a des virages abrupts et des dénivelés que je suis seul à voir, “regardez-le tituber”, ils disent, “il va tomber”, ils disent, mais non, je me raccroche toujours, je tombe pas, moi, je suis solide comme un roc, mais ça personne ne le voit, y’a que mon frère qui le voyait, mon frère, y’a que lui qui m’aimait, et t’as bien fait de me resservir, tiens, pour que je trinque avec lui, et j’en veux bien un autre, et après je m’en vais : un dernier pour la route, parce que dehors il fait froid et que le chemin est long. »
Ce texte a été écrit à partir de travaux réalisés dans le cadre d’un atelier d’écriture proposé par François Bon à l’été 2013.
Lancé à l’initiative de Neil Jomunsi, le Ray’s Day vise à célébrer l’amour du lire. Vous trouverez en détail ici toutes les explications et la liste des participants et leurs contributions.
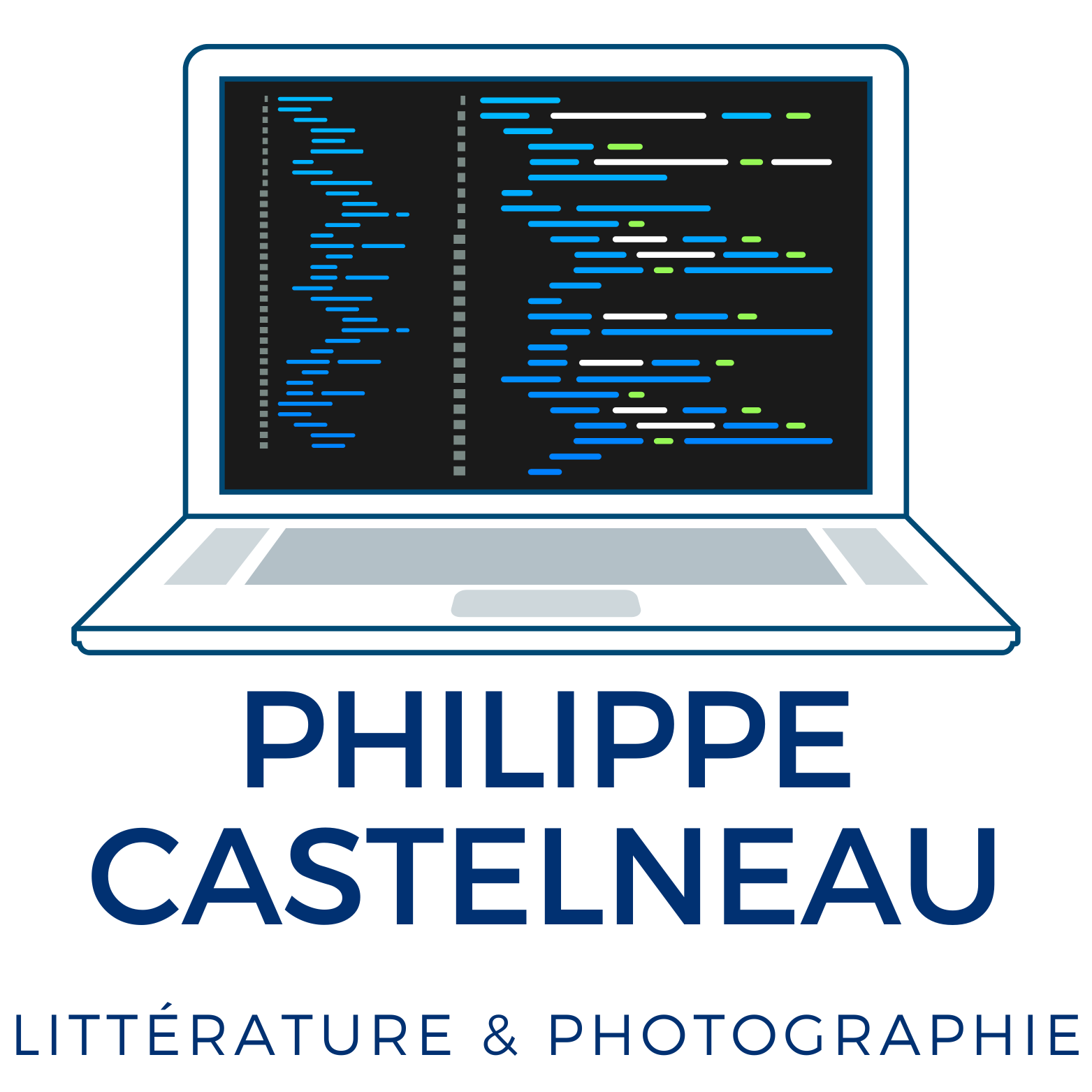



Laisser un commentaire